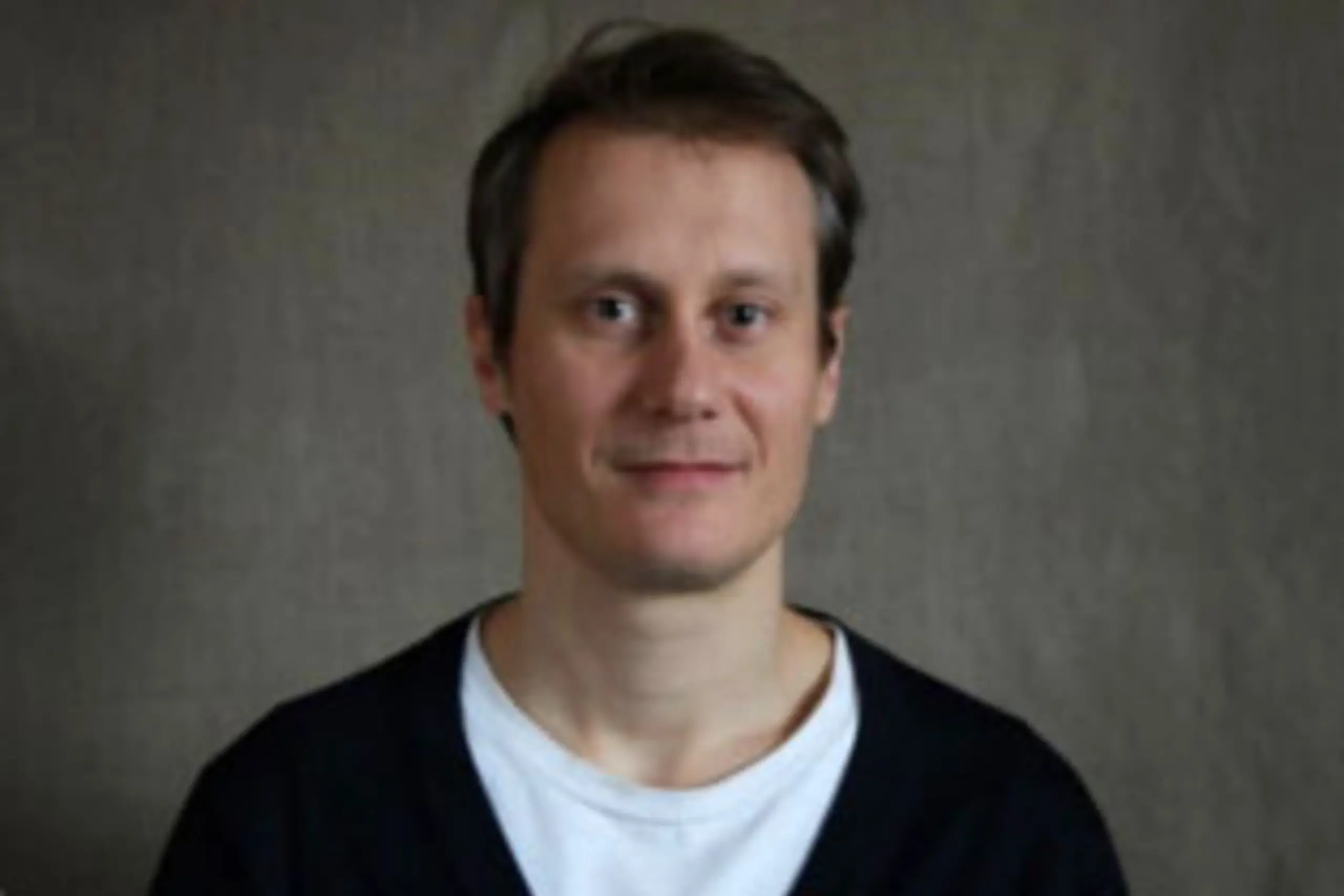
Les neurosciences et la psychanalyse sous le regard de la philosophie. Interview de Steeves Demazeux
Steeves Demazeux, philosophe et historien des sciences, auteur de plusieurs ouvrages dont deux aux éditions Ithaque: «Qu’est-ce que le DSM?» et «L’éclipse du symptôme»
L’opposition entre la psychanalyse et les neurosciences est souvent mise en avant, même si l’on observe que des convergences se font depuis plusieurs années : qu’en pensez-vous du point de vue de la philosophie des sciences ?
Le statut épistémologique de la psychanalyse est un vieux casse-tête pour les philosophes des sciences, et il est difficile de donner un avis prudent et impartial sur la question ! Il vaut toujours la peine de commencer par rappeler que Sigmund Freud, avant d’être l’inventeur de la psychanalyse, était neurologue de formation et qu’il a passé sa vie à vouloir raccrocher la psychanalyse au train des sciences naturelles. Quand il meurt, en 1939, il laisse une théorie et une pratique clinique extrêmement riches mais aux bases épistémologiques fragiles.
Très tôt, les philosophes ont été intrigués par la configuration singulière du savoir psychanalytique. Certains, comme Ricoeur ou Habermas, ont vu dans la psychanalyse une méthode à ce point originale qu’elle pourrait servir de modèle à toutes les sciences humaines, et qu’il faudrait donc la retirer (quoi qu’en eût dit Freud) du domaine des sciences naturelles. D’autres philosophes, comme Popper ou Grünbaum, ont pris au sérieux les ambitions naturalistes de la psychanalyse, mais ont cherché à montrer que Freud et ses successeurs avaient failli sur le plan scientifique.
Au lieu de réfléchir à de possibles points de convergence [entre neurosciences et psychanalyse], on a alors assisté à une rigidification des positions perçues comme antagonistes.
À partir des années 1980, ce débat difficile, utile et plutôt sain sur le plan épistémologique a dégénéré en polémiques interminables, aux allures guerrières (les « Freud wars »), où les invectives et les procès d’intention ont remplacé les arguments. Au lieu de réfléchir à de possibles points de convergence, on a alors assisté à une rigidification des positions perçues comme antagonistes : les neuroscientifiques, forts des progrès de leur discipline et aussi de la difficulté de la psychanalyse de prouver son efficacité suivant les critères de l’Evidence-based medicine, ont répété à l’envi que la psychanalyse n’était qu’une pseudo-science, tandis que beaucoup de psychanalystes se sont détournés des recherches entreprises dans les neurosciences, considérées par eux comme réductionnistes, scientistes – quand elles ne sont pas soupçonnées d’être au service d’une conception idéologique et mercantile du soin.
Je pense que toutes ces polémiques stériles sont autant révélatrices des tensions et des crispations professionnelles qui existent dans le domaine du soin que des difficultés proprement épistémologiques qui se posent à l’intersection entre psychanalyse et neurosciences. Je crois profondément que la psychanalyse a encore un avenir devant elle, à condition qu’elle accepte ce qui est exigible de toute science en progrès : qu’elle se rénove, qu’elle remette sur le chantier empirique ses hypothèses théoriques les plus audacieuses. Mais le progrès doit venir aussi du côté des neurosciences, dont la rigidité des protocoles expérimentaux pose aujourd’hui des contraintes difficiles à surmonter quand on veut tester des mécanismes impliquant des états cognitifs un tant soit peu complexes.
Je crois profondément que la psychanalyse a encore un avenir devant elle, à condition qu’elle accepte ce qui est exigible de toute science en progrès […]. Mais le progrès doit venir aussi du côté des neurosciences.
Le courant de la neuro-psychanalyse, qui a émergé aux États-Unis et dans quelques autres pays du monde dans le courant des années 1990 (dans le sillage notamment des travaux d’Allan Shore et de Mark Solms), a tenté d’établir des passerelles entre les deux domaines. Les résultats ne sont pour l’instant pas probants, mais l’effort existe. On peut par ailleurs souligner le rôle positif qu’ont joué certaines personnalités influentes comme le neurologue et philosophe Antonio Damasio ou encore le psychiatre Eric Kandel, prix Nobel de médecine en 2000 pour ses travaux sur les mécanismes neuronaux de la mémoire : leur bienveillance à l’égard des théories psychanalytiques a été perçu comme la promesse d’une réhabilitation possible de la psychanalyse dans les recherches fondamentales. Enfin, notons que si les convergences ne sont pas possibles sur le plan théorique, peut-être y-aura-t-il toujours quelque chose à encourager au niveau de l’articulation des soins, simplement pour aider les patients à aller mieux…
Le pire est cette situation de dénigrement et d’ignorance réciproque qu’on connaît depuis quelques décennies en France.
Quoi qu’il en soit, le pire est cette situation de dénigrement et d’ignorance réciproque qu’on connaît depuis quelques décennies en France : certains psychanalystes ont des poussées d’urticaire dès ils entendent prononcé « cerveau » ; et il m’arrive de rencontrer de brillants étudiants en neurosciences qui n’ont pas de mots assez durs contre la psychanalyse, mais qui n’ont jamais lu une ligne de Freud (et quand on discute avec eux, certains ne sont pas loin d’épouser des théories sur le psychisme moins assurées que les moins assurées des théories psychanalytiques).
Pour vous, de quoi parle-t-on quand on évoque la psychiatrie scientifique d’un point de vue épistémologique ?
Je ne conçois pas qu’on puisse aujourd’hui étudier les maladies mentales sans passer par les neurosciences. Leur centralité, d’un point de vue épistémologique, me semble tout à fait garantie et justifiée. Maintenant, que les neurosciences soient centrales dans les recherches psychiatriques ne doit pas signifier qu’elles sont exclusives. Je pense que c’est à ce niveau que réside une grande partie des difficultés pour la psychiatrie contemporaine. Ce qu’on ne parvient pas à bien faire, c’est à articuler les connaissances dont nous disposons sur le cerveau (et qui s’enrichissent d’année en année) avec l’ensemble des savoirs cliniques, épidémiologiques, génétiques et épigénétiques dont nous disposons par ailleurs.
Que les neurosciences soient centrales dans les recherches psychiatriques ne doit pas signifier qu’elles sont exclusives.
Prenons l’exemple des RDoC [Research Domain Criteria], financés aux États-Unis par le NIMH. Voilà un projet ambitieux qui cherche à refonder la psychiatrie sur de solides bases neuroscientifiques. Le problème, quand on regarde de près la structure du projet, c’est qu’elle laisse dans le vague les questions les plus essentielles qui se posent en psychiatrie : quelle est l’influence des facteurs psycho-sociaux ? Quelle est la place des représentations sociales, symboliques et culturelles ? L’importance de la trajectoire biographique dans la pathogenèse des troubles mentaux ? Comment transcrire la sémiologie psychiatrique dans le vocabulaire rigoureux des neurosciences cognitives ? Comment articuler les modèles théoriques aux pratiques de soin ? etc.
D’une manière très générale, je n’ai, en tant que philosophe des sciences, pas plus de difficulté à dire que la psychiatrie est scientifique que je le dirais de n’importe quelle autre discipline médicale. D’abord, je ne crois pas qu’on puisse trouver un critère univoque qui permette de dire quand un domaine de connaissances est « scientifique » et quand il ne l’est pas. Ce qu’on appelle le problème de la « démarcation » entre science et non-science (qui est un vieux problème de philosophie des sciences) n’admet pas de solution simple, n’en déplaise à Karl Popper.
Ensuite, je pense qu’il faut en finir avec le vieux soupçon hérité de l’antipsychiatrie des années 1960, qui voulait que la psychiatrie soit une discipline en mal de rationalité et de scientificité. Certes, la psychiatrie restera toujours, pour des raisons profondes, une discipline un peu spéciale dans la pratique du soin : mais au niveau de ses concepts, de ses méthodes et de ses outils, rien aujourd’hui ne justifie qu’on l’accuse d’un retard ou d’un défaut quelconque de scientificité par rapport au reste de la médecine. À bien y regarder, la plupart des difficultés qu’elle rencontre, on les retrouve en cancérologie, en virologie, et dans de nombreuses autres disciplines médicales. Même sa fragilité nosologique n’a rien d’exceptionnel… Et à mesure qu’on se fait une idée plus complexe de ce que c’est qu’une maladie en médecine somatique (comme le cancer, le diabète, certaines maladies auto-immunes), le statut de la maladie mentale apparaît de moins en moins mystérieux.
À bien y regarder, la plupart des difficultés [que la psychiatrie] rencontre, on les retrouve en cancérologie, en virologie, et dans de nombreuses autres disciplines médicales. Même sa fragilité nosologique n’a rien d’exceptionnel…
Il y a assurément en psychiatrie certaines pratiques et certaines étiquettes diagnostiques fragiles sur le plan scientifique, parfois même très douteuses. Il y a aussi des conflits d’intérêts et des biais de publication. Mais l’important est que n’importe quel clinicien ou chercheur en psychiatrie qui avancerait une proposition non empiriquement étayée serait aujourd’hui immédiatement critiqué par ses collègues. On ne peut plus affirmer d’autorité, comme cela a longtemps été le cas, la vérité d’un fait clinique du haut de sa seule expérience personnelle. Cela, je pense, est un gain essentiel de la modernité psychiatrique.
Il n’empêche que ce qu’il manque à la psychiatrie depuis longtemps, c’est une découverte fondamentale qui toucherait directement à l’un de ses troubles mentaux les plus emblématiques. Une découverte qui s’imposerait à travers un consensus scientifique fort – qui serait par exemple récompensé par cette vitrine sociale du progrès scientifique qu’est un prix Nobel. La psychiatrie a besoin de cela, non pas pour être plus scientifique (il faut insister sur le fait que ce n’est pas parce qu’elle ne parvient pas à percer le secret de maladies très complexes qu’elle peut être dite « non-scientifique »), mais simplement pour que sa scientificité soit mieux reconnue.
Étant donnée la profondeur de la déconsidération sociale de la psychiatrie (cela est particulièrement sensible en France actuellement), ce besoin de reconnaissance scientifique et sociale est important – même s’il n’est pas primordial, le primordial restant d’améliorer la prise en charge des personnes atteintes de maladies mentales. Or cette prise en charge coûte cher à la société, et il n’y a, je le crains, pas à attendre la découverte d’un traitement miracle à bas coût pour soigner les malades mentaux. Il s’agit d’abord d’un choix social et politique qu’il faut assumer et faire valoir en tant que tel : le véritable soin en médecine mentale coûte cher, et il continuera longtemps de coûter cher, quelle que soit l’ampleur des progrès scientifiques accomplis.
Bibliographie
- Demazeux S., Qu’est-ce que le DSM ? Genèse et transformations de la bible américaine de la psychiatrie, Paris, Ithaque, 2013.
- Demazeux S. & Singy P. (Eds.), The DSM-5 in Perspective: Philosophical Reflections on the Psychiatric Babel, Dordrecht, Springer, 2015.
- Wakefield, J.C., & Demazeux, S. (Eds.), Sadness or depression? International perspectives on the depression epidemic and its meaning. Dordrecht, Springer, 2016.
- Demazeux S., L’éclipse du symptôme. L’observation clinique en psychiatrie : 1800-1950, Paris, Ithaque, 2019.


