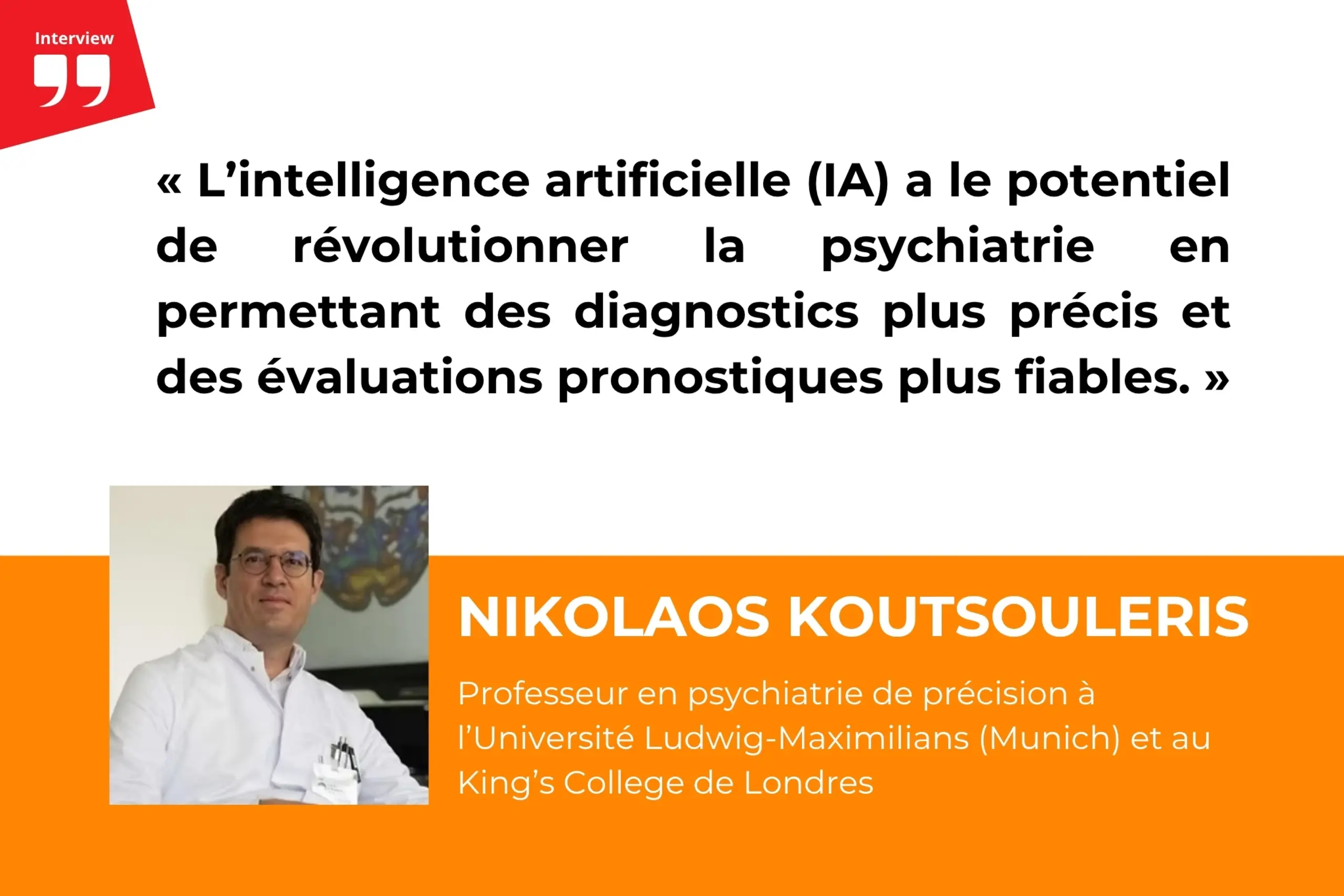
L’intelligence artificielle (IA) a le potentiel de révolutionner la psychiatrie en permettant des diagnostics plus précis et des évaluations pronostiques plus fiables.
Nikolaos Koutsouleris
Professeur en psychiatrie de précision à l’Université Ludwig-Maximilians (Munich) et au King’s College de Londres
Comment l’IA et le machine learning amélioreront-ils le diagnostic et le traitement des troubles psychiatriques, en particulier aux stades précoces ? Pourriez-vous partager certains résultats de vos travaux et expliquer leur fonctionnement ?
L’intelligence artificielle (IA) a le potentiel de révolutionner la psychiatrie en permettant des diagnostics plus précis et des pronostiques plus fiables. Grâce au machine learning1, domaine de l’intelligence artificielle qui vise à donner aux machines la capacité d’apprendre d’elles-mêmes en analysant d’énormes quantités de données, nous pouvons détecter des schémas complexes dans les données, essentiels pour comprendre les troubles psychiatriques, qui sont intrinsèquement complexes et ne se prêtent pas à des classifications simples.
Pour appréhender pleinement ces pathologies, il faut intégrer plusieurs domaines de données, notamment les facteurs biologiques, cliniques et environnementaux. L’IA est capable d’analyser ces couches d’informations diverses, ce qui en fait un outil puissant pour saisir la complexité des troubles mentaux et différencier les pathologies avec plus de précision.
Aujourd’hui, les diagnostics psychiatriques reposent largement sur des évaluations cliniques et des entretiens avec les patients, qui sont subjectifs. Un changement de paradigme se produirait si nous pouvions exploiter des sources de données plus objectives pour améliorer la précision diagnostique.
Prédire le risque de psychose avec l’IA
Actuellement, sur la base de critères cliniques, on estime qu’un patient présentant un syndrome de risque de psychose a 30 % de chances de développer une psychose dans les 3 à 4 ans. Ce niveau de précision est insuffisant pour un diagnostic individuel. Identifier le risque individuel reste un challenge, car les règles prédictives sont difficiles à établir.
Mes recherches sur la reconnaissance précoce des troubles psychotiques montrent que les modèles de machine learning intégrant des données issues de l’imagerie et de la génétique peuvent atteindre jusqu’à 86 % de précision pour prédire l’apparition d’une psychose.
Ces troubles apparaissent souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte (âge critique : 18-22 ans), bien qu’ils puissent survenir plus tôt. Intégrer l’IA dès les stades précoces permet d’établir des diagnostics plus précis et de réduire le délai de traitement — généralement plus léger qu’en phases avancées de la maladie.
IA et réponse au traitement dans la schizophrénie
L’IA transforme également la prédiction des réponses au traitement. Par exemple, pour la stimulation magnétique transcrânienne (TMS) dans la schizophrénie, nous avons montré que l’imagerie, les données cliniques et génétiques permettent de prédire les résultats.
En optimisant les séquences à examiner, nous pouvons maximiser la précision des prédictions tout en réduisant le nombre de tests nécessaires — diminuant ainsi les coûts et les contraintes pour les patients.
Prédiction de l’évolution fonctionnelle dans la psychose du premier épisode
Autre exemple innovant : l’utilisation des données cliniques issues des soins courants pour prédire l’évolution fonctionnelle des patients ayant vécu un premier épisode psychotique.
Dès un mois de suivi, notre modèle atteint un taux de précision de 73 %. Un an après, il maintient 71 % de précision, une première pour un modèle prédictif dans ce contexte.
Ces avancées démontrent que l’approche basée sur l’IA peut affiner les diagnostics psychiatriques, améliorer les plans de traitement et mener à une psychiatrie plus personnalisée et plus efficace.
Quels sont les principaux défis liés à l’intégration de l’IA et des modèles d’apprentissage automatique dans la pratique clinique, en particulier en psychiatrie ?
L’un des principaux défis est le biais dans les données. Les données des patients sont souvent influencées par le contexte socio-économique, l’origine, l’ethnicité et le genre, autant de facteurs qui interagissent avec le phénotype du patient. Cela peut introduire des biais dans les modèles d’IA et les rendre moins inopérant sur la population globale.
Un exemple frappant : le fait que les modèles d’IA identifient mal certaines conditions chez les patients noirs, ou recommandent des dosages inappropriés, trop élevés ou trop faibles. Si ces biais ne sont pas corrigés, l’IA risque d’aggraver les inégalités existantes plutôt que de les atténuer.
Autre défi majeur : le manque de transparence des modèles d’apprentissage de l’IA. L’IA fonctionne souvent comme une boîte noire : ni les cliniciens ni les patients ne comprennent comment la prédiction a été générée. C’est particulièrement problématique en psychiatrie, où les professionnels ont besoin d’explications claires pour guider leur décision.
Par exemple, si un modèle prédit un risque élevé de psychose, le clinicien doit savoir pourquoi, afin d’adapter le traitement. La transparence est donc essentielle, et les régulateurs européens l’ont déjà reconnue comme un critère fondamental dans l’utilisation de l’IA en santé.
Troisième défi : la réticence de certains professionnels à adopter les outils d’IA. Beaucoup craignent que la technologie ne remplace leur jugement clinique. Que faire si la prédiction de l’IA contredit leur évaluation ?
Pour résoudre cette tension entre intelligence humaine et artificielle, il faut intégrer l’IA comme outil de soutien, et non comme substitut. Les cliniciens doivent être formés à interpréter les résultats générés par l’IA, afin de garder la main sur la décision médicale.
La réussite de l’IA en psychiatrie repose donc sur la gestion des biais, la transparence et l’engagement des professionnels, afin que ces technologies renforcent les soins psychiatriques au lieu de les perturber.
Pourriez-vous expliquer comment vos outils, qui analysent des biomarqueurs clés, prédisent les évolutions dans la dépression ou la psychose, et évaluent la prise de décision dans la psychose, pourraient transformer les traitements ou les stratégies préventives ?
L’impact de l’IA en psychiatrie dépend de l’algorithme utilisé. Globalement, les modèles d’IA apprennent des règles à partir de données pour classifier ou prédire des troubles, comme les différents sous-types de dépression. Mais au-delà du diagnostic, nous devons utiliser ces modèles pour découvrir de nouveaux traitements et orienter la décision clinique.
Une fois les schémas appris, un modèle peut cartographier un individu dans un espace décisionnel et mesurer sa distance par rapport à certaines frontières diagnostiques. Cela permet d’établir des probabilités : « Ce patient présente un sous-type A à 80 %, et un sous-type B à 20 % ». Les variables biologiques et neurologiques en jeu sont alors mises en évidence.
Avec le consentement des patients, ces signatures au sein des modèles pourraient être analysées par les laboratoires pharmaceutiques pour identifier les gènes, systèmes neuronaux et mécanismes psychologiques associés à chaque sous-type. Une meilleure compréhension des mécanismes ouvrirait la voie à des traitements ciblés et personnalisés.
Actuellement, notre compréhension des troubles psychiatriques reste globale. L’IA permet d’en révéler les mécanismes sous-jacents, ouvrant la voie à une psychiatrie de précision.
Avec l’essor de l’IA appliquée à la psychiatrie de précision, quels sont les avantages potentiels en termes d’accès au soin, et les risques éthiques associés à l’analyse clinique automatisée ?
L’un des plus grands bénéfices de l’IA serait de réduire le délai d’accès aux soins. C’est probablement la percée la plus prometteuse : aujourd’hui, il faut parfois des années à un patient (notamment psychotique) pour trouver un professionnel adapté. Beaucoup passent de médecin en médecin, pendant que leur état s’aggrave.
L’IA peut accélérer ce parcours et prévenir l’aggravation de la maladie liée au retard de traitement.
Même après un diagnostic, le traitement repose souvent sur un processus d’essais-erreurs qui peut prendre des mois voire des années. Les modèles d’IA pourraient identifier rapidement le traitement le plus adapté, réduisant ainsi la souffrance des patients.
Mais ces outils comportent aussi des risques et des challenges d’ordre éthique. Des modèles entraînés sur des données non représentatives peuvent perpétuer les inégalités et générer des décisions dangereuses et non éthiques. Il faut éviter que l’IA ne devienne un outil réservé aux populations favorisées, ce qui creuserait les inégalités d’accès aux traitements. Enfin, l’IA ne doit pas remplacer les psychiatres. Il existe un danger de surdépendance.
L’intelligence artificielle offre de nouvelles opportunités aux populations mal desservies. Une personne sur trois connaîtra un trouble de santé mentale au cours de sa vie, et pourtant, il n’y aura jamais assez de psychiatres pour répondre à cette demande. L’IA pourrait agir comme un compagnon numérique de première ligne, apportant orientation et soutien, en particulier dans les régions où l’accès aux professionnels de la santé mentale est limité.
Imaginez un monde où un psychiatre numérique est disponible au bout des doigts, accessible depuis un smartphone. Cela pourrait transformer en profondeur les soins en santé mentale, en rendant l’accompagnement accessible à celles et ceux qui, autrement, n’en recevraient aucun.
De quoi ce nouveau domaine de recherche a-t-il besoin pour se développer ?
Pour que l’intelligence artificielle (IA) puisse déployer tout son potentiel dans le domaine de la santé mentale, plusieurs défis majeurs doivent être relevés, à commencer par la formation des professionnels de santé. Les étudiants en médecine devraient être initiés aux approches de la médecine de précision fondée sur l’IA dès le début de leurs cursus, afin que les futurs praticiens sachent interpréter et appliquer les enseignements issus de ces technologies, en psychiatrie comme dans d’autres spécialités médicales.
Un autre enjeu crucial concerne la standardisation accrue de la psychiatrie de précision. Les méthodologies utilisées dans la recherche en IA doivent être transparentes pour limiter les biais et améliorer la reproductibilité des résultats.
Pour que l’IA soit réellement efficace, les bases de données doivent être librement accessibles, afin de permettre aux chercheurs de collaborer et de se concurrencer pour développer de meilleurs modèles. Cela nécessite une transition vers des données ouvertes, standardisées et organisées, représentant fidèlement l’ensemble de la population, afin de réduire le risque d’algorithmes biaisés ou non généralisables.
C’est pourquoi des pays comme l’Allemagne et la France doivent accélérer la numérisation de leurs systèmes de santé. Des données patient sécurisées et anonymisées, recueillies lors de consultations médicales et stockées avec le consentement des patients, pourraient être exploitées pour la recherche IA dans tous les domaines de données, notamment l’imagerie médicale, les analyses sanguines, etc., en vue de produire des modèles prédictifs.
Un financement conséquent est indispensable pour accélérer le développement et la validation des modèles d’IA. Les gouvernements et les organismes financeurs doivent investir dans des infrastructures de partage de données et dans des environnements de recherche sécurisés, où des jeux de données standardisés et de haute qualité pourraient être analysés à l’aide des techniques de machine learning les plus avancées.
En construisant un écosystème d’IA transparent, inclusif et bien réglementé, nous pourrons garantir que les modèles appliqués à la psychiatrie servent réellement les différentes populations qu’ils sont censés aider, tout en préservant la confiance, la précision et l’équité dans l’accès aux soins.


